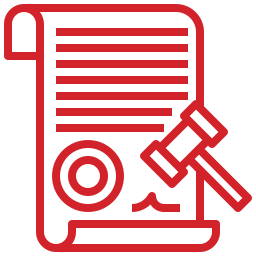Illustration d’une faute lourde (Cass.soc. 28 octobre 2014, n°13-19.609
Un comptable convoqué à un entretien préalable au licenciement par son employeur, avait retenu l’ensemble des données comptables de l’association à compter dudit entretien préalable. Cette rétention avait causé la paralysie de l’activité de l’association car elle n’avait plus accès au logiciel de comptabilité et ne pouvait ni émettre de facture ni enregistrer de recettes. L’association avait à la suite licencié le comptable pour faute lourde. Le comptable a contesté cette qualification au motif que l’intention de nuire était pas constituée. Les juges ont considéré que la volonté de nuire découlait ici directement des faits. La rétention de la comptabilité à la suite de l’entretien préalable au licenciement manifestait la volonté du salarié de paralyser le fonctionnement de l’entreprise et donc de nuire à son employeur.
Un salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et dans l’attente de cet entretien avait été mis à pied à titre conservatoire. À la suite de l’entretien, l’employeur a notifié le licenciement au salarié pour cause réelle et sérieuse, en omettant par ailleurs de payer la période de mise à pied. La Cour de Cassation, rappelant ici que seul le motif de la faute grave ou de la faute lourde, autorise l’employeur à ne pas payer la mise à pied a jugé qu’en l’espèce le défaut de paiement de la mise à pied constituait en elle-même une sanction. En conséquence, le licenciement devait être analysé comme une deuxième sanction des mêmes faits le rendant de ce simple fait sans cause réelle et sérieuse.
La loi 2008-596 du 25 juin 2008 a institué un délai de prévenance en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai. Ce délai, lorsque la rupture est du fait de l’employeur, est de 24 heures en deçà de huit jours de présence ; 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; 2 semaines après un mois de présence ; 1 mois après 3 mois de présence. La loi ne prévoyait cependant pas la sanction en cas de non observation du délai de prévenance. La question était donc de savoir si le non respect de ce délai était sanctionné par la requalification de la rupture en licenciement.
La Cour de Cassation a refusé cette qualification. Dés lors que la rupture a lieu au cours de la période d’essai, le contrat est rompu à ce titre. Le non-respect du délai de prévenance peut constituer une cause d’indemnisation du salarié à hauteur de la durée du préavis non respecté.
La rétrogradation du salarié, même prise au titre d’une sanction disciplinaire, constitue une modification du contrat de travail. À ce titre, elle doit être acceptée par lui. Dans l’hypothèse d’un refus, il est possible pour l’employeur de prendre une mesure disciplinaire de substitution qui peut aller jusqu’au licenciement. Néanmoins l’employeur doit veiller au jeu de la prescription de la sanction disciplinaire qui est de deux mois après les faits fautifs. Ainsi, la mesure de sanction disciplinaire de substitution doit intervenir dans un délai maximal de deux mois à compter du refus du salarié de sa rétrogradation disciplinaire, elle-même devant respecter le délai de deux mois à compter des faits fautifs ou de la connaissance de ceux-ci. A défaut, la sanction serait privée d’effet.
Après la question du pouvoir du signataire du courrier de licenciement dans le cadre de la SAS qui est à l’origine de jurisprudences contradictoires de cours d’appel, finalement réglées par la Cour de cassation ; la Haute juridiction continue à contrôler la validité des délégations de responsabilité qui autorisent les salariés de l’entreprise à engager une procédure de licenciement.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé à l’occasion de ses arrêts qu’un intérimaire pouvait bénéficier d’une délégation pour signer le courrier de licenciement même si, de droit, il n’est pas salarié de l’entreprise utilisatrice.
Cependant, la Cour de cassation a énoncé dans son arrêt « qu’un travailleur temporaire n’est pas une personne étrangère à l’entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission », ce qui légitime qu’il puisse bénéficier de délégation de pouvoir le temps de la durée de sa mission.
En revanche, la délégation de pouvoir accordée à un salarié dans l’entreprise doit être conforme au statut de l’entité qui l’emploie.
En l’occurrence, la Cour de cassation a constaté que les statuts de l’association employant le salarié délégataire réglementaient la question de la transmission de sa délégation.
Or, celle-ci n’avait pas été formellement réalisée dans les termes des statuts.
La Cour de cassation a donc considéré que la délégation était nulle, et par voie de conséquence le licenciement notifié par l’intéressé est dénué de cause réelle et sérieuse, par faute de qualité à agir du signataire.
La Cour de cassation a rappelé l’exigence de motiver précisément le courrier de licenciement.
Cette règle s’impose en toute circonstance, même en la présence d’une règle statutaire précisant que le retrait de l’agrément du salarié, nécessaire à l’exercice d’une fonction, implique son licenciement.
En l’occurrence, la directrice d’un établissement scolaire d’enseignement catholique s’était vue retirer son agrément de directrice d’établissement par son organisme de tutelle.
Elle avait été licenciée par son employeur sur ce motif.
Cependant, selon les juges, le courrier de licenciement ne peut pas être motivé sur cette seule circonstance, même si celle-ci est une cause de licenciement selon les statuts.
En effet, le seul motif du défaut d’agrément ne permet pas aux juges d’apprécier les motifs réels de retrait, et donc d’apprécier la réalité du motif du licenciement.
Un salarié, qui avait tenu des propos désobligeants vis-à-vis de sa hiérarchie devant des salariés, a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
La Cour de cassation a soutenu l’analyse des juges du fond qui avaient estimé que la faute grave ne pouvait être retenue, compte tenu des circonstances où les propos désobligeants avaient été tenus (la modification du poste du salarié concerné), son ancienneté et l’absence de précédent.
La Cour de cassation rappelle ainsi qu’il appartient toujours aux juges du fond d’apprécier les faits à l’origine de la sanction et leur qualification.
La Cour de cassation a tranché une question récurrente sur la computation des délais en matière de convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Rappelons que celui-ci doit être de cinq jours ouvrables suivant la date de première présentation du courrier.
Lorsque la date de l’entretien préalable a été reculée à la demande du salarié, quel est le point de départ à prendre en considération pour vérifier que le délai de 5 jours ouvrables a bien été respecté ?
Dans cette hypothèse, la Cour de cassation juge que le délai doit courir à compter de la présentation de la première convocation et non de la deuxième, lorsque la date du premier entretien a été déplacée à la demande du salarié.
La loi du 20 août 2008 prévoit que la détermination de la représentativité syndicale, basée sur la mesure de l’audience électorale, ne s’applique qu’à compter des premières élections professionnelles.
Trois espèces en date du 10 mars 2010 nous apportent des précisions concernant l’appréciation des critères de représentativité syndicale posés par la loi du 20 août 2008
Selon la loi, un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption transitoire de responsabilité peut établir celle-ci soit par affiliation postérieure à l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit par la preuve qu’il remplit les nouveaux critères légaux de représentativité (de L.2121-1 CT) à l’exception de celui fondé sur l’obtention d’un score électoral de 10%.
Dans cette espèce, après maints rappels à l’ordre, un salarié est mis à pied à titre conservatoire par son employeur dans l’attente de son licenciement. Ce dernier est prononcé par la suite pour cause d’insuffisance professionnelle.
Le salarié conteste alors ce licenciement en justice au motif que la mise à pied conservatoire ne peut être préalable qu’à un licenciement pour motif disciplinaire et non pour un autre motif. L’argument du salarié était fondé sur l’article L.1332-3 CT qui suppose une faute grave pour invoquer une mise à pied conservatoire.
La Cour juge cependant qu’une mise à pied à titre conservatoire peut donc être indifféremment le préalable à un licenciement pour cause d’insuffisance professionnelle ou pour cause disciplinaire. A noter que durant cette mise à pied, l’employeur devra rémunérer le salarié.
Dans cette espèce, un notaire a trouvé sur l’ordinateur d’un de ses salariés des courriers dénigrant l’étude auprès des tiers. Ce salarié fut licencié pour faute grave au motif de propos diffamatoires.
Le salarié ainsi que la Cour de cassation font état dans cette affaire d’une jurisprudence selon laquelle « sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers, identifiés par le salarié comme personnels, contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition, qu’en présence de ce dernier ou si celui-ci fût dument appelé » (cass.soc. 17 mai 2005 n°03-40017).
Cependant, la Cour considère également que l’utilisation de l’outil informatique fourni sur le lieu de travail laisse présumer un caractère professionnel des fichiers, de sorte que l’employeur peut les consulter en l’absence du salarié (cass.soc. 21 octobre 2009, n°07-43877). Les fichiers nommés « essais divers etc. » ayant laissé entendre à l’employeur qu’ils étaient dénués d’effet personnel, celui-ci a pu à bon droit croire en leur caractère professionnel.
Dans une affaire jugée récemment, un commercial a vu son permis de conduire suspendu pour conduite en état d’ivresse en dehors de son temps de travail.
Il est licencié pour faute grave au motif que « cette situation ne vous permet plus d'exercer votre activité professionnelle, qui consiste en visites de clients de votre ressort géographique. Par ailleurs, ce fait porte gravement atteinte à l'image de l'entreprise, que vous représentez auprès de vos clients ».
Le salarié conteste la validité de son licenciement, car 2 anciens collègues avaient accepté de le conduire à ses rendez-vous : il n’était donc pas dans l’impossibilité d’exécuter son travail.
Les juges sont catégoriques et rejettent sa contestation : le salarié ne pouvait plus remplir ses missions par ses propres moyens et l’employeur n’est pas tenu d’accepter que des tiers prennent en charge les déplacements professionnels du salarié.
Une entreprise a licencié un chauffeur routier au motif que ce dernier avait commis au cours du mois de janvier 2006 divers excès de vitesse (un sanctionné par une amende de 135 € en roulant à 80 au lieu de 50 km/h un jour de janvier 2006, neuf autres apparus lors du relevé des disques de contrôle).
Les juges du tribunal, puis de la cour d’appel de Rouen, avaient estimé que les excès de vitesse reprochés au salarié ne pouvaient pas être qualifiés de faute grave et avaient condamné l’entreprise à indemniser le chauffeur.
A l’issue de trois ans de procédure, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les « excès de vitesse dans la conduite de l’ensemble poids lourd » montraient que le salarié « avait persisté dans son comportement fautif » ce qui était bien constitutif d’une faute grave. Déclarant le licenciement « fondé sur une faute grave », elle a ainsi requalifié les faits et a annulé la condamnation de l’entreprise, qui récupérera les indemnités de licenciement et de préavis qu’elle a versées.
L’employeur ne peut imposer à un salarié une sanction disciplinaire entraînant une modification de son contrat de travail.
En cas de refus du salarié, l’entreprise peut prendre une autre sanction, par exemple un licenciement.
En l’espèce, un salarié avait contesté en justice la décision de rétrogradation prise unilatéralement par l’entreprise. Celle-ci avait ultérieurement licencié le salarié au motif d’une faute grave.
Les juges ont considéré que la décision unilatérale de rétrogradation, même si elle ne pouvait pas être effective puisque l’employeur, en l’espèce, n’avait pas demandé l’accord du salarié sur la modification de son contrat de travail, constituait néanmoins une sanction disciplinaire.
Dès lors, le licenciement pour faute grave, prononcée ultérieurement, constituait une double sanction pour le même fait, rendant ainsi le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a jugé que le refus par le salarié d’un changement de conditions de travail peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais ne constitue pas en lui seul une faute grave.
La Cour de cassation a jugé que les juges du fond ont la faculté d'évaluer si les termes d'un « courrier de recadrage » envoyé à un salarié sous forme de mail par son supérieur hiérarchique valent avertissement au sens du droit disciplinaire. Dans l'affirmative, les faits reprochés au salarié ne peuvent être sanctionnés une nouvelle fois à l'occasion d'une procédure de licenciement.
En effet selon la Cour de cassation, la définition légale de la sanction est très large : il s'agit de « toute mesure » autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement qu'il considère comme fautif. Dès lors des « mises en garde » adressées par mail à un salarié peut constituer un avertissement.